FILMER LA BANDE DESSINÉE :
L'OUBAPO AU TRAVAIL
HISTOIRE(S) DE LA BANDE DESSINÉE
Il y a peu encore, la bande dessinée était considérée comme un pis-aller de la littérature, un moindre mal destiné à pousser la jeunesse vers une lecture de livres plus « nobles ». En France, le premier groupe de critique militante en faveur de la bande dessinée (créé entre autres par Alain Resnais) date seulement des années 60, alors que la bande dessinée est déjà plus que centenaire. Aujourd’hui encore, beaucoup ne voient en ce médium qu’une sous-littérature, une sous-peinture et un sous-cinéma, à destination des nostalgiques et des collectionneurs fétichistes.
Il faut pourtant avoir à l’esprit que dès l’invention vers 1837 de la bande dessinée moderne par Rodolphe Töpffer, celui-ci éprouve le besoin de théoriser sa pratique. Déjà premier auteur de bande dessinée, Töpffer signe l’un des premiers ouvrages théoriques du « 9ème art » et se met en quête de reconnaissance auprès des grands penseurs de son époque (il trouvera notamment une oreille enthousiaste auprès de Goethe).
Médium sitôt créé, sitôt questionné par ses créateurs, la bande dessinée est rapidement prise d’envies d’explorations, puis d’expérimentations. Ainsi, dès 1903, les upside-downs de Gustave Verbeck, strips ingénieux lisibles à l’endroit comme à l’envers ; ou encore, à la même époque, les bandes à la rigueur toute géométrique et aux principes narratifs systémiques de Windsor McKay, le créateur du mythique Little Nemo, à qui la plupart des historiens de la bande dessinée attribuent l’invention du gros plan et du travelling dans un récit séquencé.
Il semble donc que la bande dessinée ait, depuis sa naissance, fréquemment ressenti la nécessité d’évoluer en questionnant son langage, en cherchant sans cesse à comprendre, souvent pour les mieux dépasser, ses propres règles et limites, ses spécificités, ses potentiels. Les exemples contemporains sont nombreux d’auteurs qui, à l’intérieur de récits populaires, s’amusent à mettre le langage de la bande dessinée à l’épreuve d’inventives éprouvettes, comme si les effets de répétition, mise en abîme, déstructuration et autres jeux formels, étaient l’essence même de leur art (voir les exemples en bas de cette page).
C’est dans cette logique que l’OuBaPo (Ouvroir de Bande dessinée Potentielle) a été créé en France en 1992. Inspiré du modèle de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentiel), association créée par Raymond Queneau en 1960, l’OuBaPo se propose de dégager et d’explorer un bouquet non exhaustif de contraintes applicables en bande dessinée (plurilecturabilité, retournements, transformations, pliages, etc.), avec l’objectif de mettre en évidence les possibilités et la variété du langage de la bande dessinée, de manière ludique et rigoureuse. La résidence Pierre Feuille Ciseaux partage cette même intention : réunir des auteurs de bande dessinée au sein d’un laboratoire de création, visant à offrir un regard neuf sur un médium encore mal connu. Découverte d'un principe en case 3 est, dans ce contexte, le témoin de certaines des contraintes les plus stimulantes imaginées par l’OuBaPo, auxquelles se confrontent aussi bien des auteurs régulièrement rattachés à ce courant, que des auteurs n’ayant pas encore posé le pied en ces terres de potentialités multiples.
En passer par l’OuBaPo permet de profiter des résultats des expériences menées par ce laboratoire joyeux, qui visent à dévoiler la part de structure, d’agencements, de mécanismes narratifs et graphiques, inhérents au langage de la bande dessinée. Ce que montre la pratique OuBaPienne, c’est que la bande dessinée est à la fois théorique et pratique, dans le même mouvement virtuelle et « en acte ». Par ses manipulations, l’OuBaPo nous fait sentir combien une bande dessinée est une totalité organique, dont les différents ingrédients et paramètres sont pris dans un réseau serré de déterminations réciproques. Ce qui est aussi le projet fondamental du film.

POURQUOI FILMER LA BANDE DESSINÉE ?
C’est justement cette complexité, cette étendue des possibles à l’intérieur du langage de la bande dessinée, qu’il est tentant de passer sous l’œil de la caméra. Alors que la bande dessinée prend de l’importance culturellement, elle reste nous semble-t-il négligée par la critique d’art et souvent incomprise dans sa spécificité. Elle fait son entrée dans les musées et les salles d’expositions, ses auteurs deviennent des personnages renommés dans le monde du cinéma (Marjane Satrapi, Joann Sfar ou Riad Sattouf) et le nombre de lecteurs exigeants ne cesse d’augmenter. Mais le « 9ème art » reste encore le parent pauvre d’une approche théorique et critique. Et sa représentation filmée, de fait, est rarissime.
Ainsi que le constate, à raison, Thierry Groensteen dans La Bande Dessinée : un Objet Culturel Non Identifié (2006, Éditions de l’An 2), « toutes les productions culturelles sont confrontées au problème de l’hyper-médiatisation d’un petit nombre d’auteurs et d’œuvres, qui a pour corollaire l’occultation de la plupart des autres. […] La bande dessinée n’y échappe pas, […] le peu de place qui lui est accordé semble accaparé par quelques ‘têtes d’affiche’, [des] ‘cas intéressants’ à proportion de [leur] caractère d’exception. […] Avec Satrapi, Sfar ou Bilal, autant que de bande dessinée, c’est de l’époque elle-même que l’on s’entretient, de ses errements, de ses déchirements et de ses impasses, avec arrêts à Téhéran, Jérusalem ou Sarajevo. »
Découverte d'un principe en case 3 prend le contre-pied de « ce phénomène de la ‘prime au sujet’ », en se concentrant non sur l’objet culturel bande dessinée, mais bien sur le travail de la bande dessinée : comment elle vient à naître, par quel processus, mélange de technique et d’invention, sa genèse survient.
Le contexte de Pierre Feuille Ciseaux est pour ce faire idéal. L.L. De Mars, un des auteurs impliqués dès la première édition de cette résidence, raconte en 2009 l’expérience suivante, qui a ici valeur d’exemple: « Aurélie William-Levaux dessine depuis quelque temps sur du fin tissu blanc ; c'est un support ingrat, dans lequel la plume se prend facilement, sur lequel les taches ne peuvent se gratter ou se couvrir, bavent, s'étalent. Il lui permet à la fois de dessiner et de broder ; mais ceci n'est que description technique et, comme telle, ne signifie pas grand-chose. Ce n'est pas un truc d'Aurélie, un effet, une manière. C'est une condition et une opération de sa vérité. Tissu, broderie, tension qu'implique maniaquement un tel absurde choix de support, sont non seulement inextricables de la chair biographique et intellectuelle à laquelle ils se sont imposés, mais ils produisent inlassablement d'autres tissages, de sens, de pratiques, d'inventions. C'est une matrice de production. Ce qu'elle produit, évidemment, est essentiellement Aurélie elle-même. Et, au passage, quelques planches magnifiques qui portent témoignage de cette advention. Les traits de plumes sont pris dans la broderie, contaminés par le verbe broder, le mouvement de l'aiguille, son sens, ses métaphores. La temporalité technique implique certaines formes restrictives du récit et ouvre à d'autres.
Tenu dans une certaine distance, on imaginerait sans doute que le travail artistique se découpe en temporalités et significations, associant le projet à l'invention, l'esquisse à la mise en forme et le reste à la réalisation. Mais ces cadres sont sans réalité ; là où ils existent, tout art a disparu pour laisser place à l'artisanat. On doit considérer la pratique comme matrice imaginante, le dessin comme jeu critique et théorique du dessin, le projet comme un agencement plastique : toutes ces zones sont entre elles poreuses, fluides, se fécondent et participent très également de l'invention comme de la technicité.
J'ai demandé à Aurélie, intrigué par l'idée tactile que je me faisais de son travail, si elle pouvait me prêter un peu de tissu, me montrer comment elle dessinait dessus : le premier travail à plusieurs mains auquel je m'étais proposé à mon arrivée poursuivait un mode d'écriture entamé depuis quelques années avec des amis dessinateurs (l'un dessine une planche, d'un geste rapide et sans préciser les contours, l'autre encre, essayant de déchiffrer là où c'est possible, déduisant de quelques traits ce qui semble manquer où être trop confus ici. Un troisième se voit confier l'écriture du texte dans les phylactères que les deux autres n'ont pas manqué de lui laisser. Une version dévoyée des anciens studios à l'Américaine, en quelque sorte). La première double planche née à la Saline de cette forme d'invitation échangea croquis et encrages de Baladi et moi-même ; je lui ai proposé un passage couleur supplémentaire pour la sérigraphie histoire de pimenter le tout. J'ai demandé à William Henne et Jean-Christophe Menu d'écrire chacun un dialogue que nous puissions permuter, par une impression sur calque. Je dessinai pour Aurélie sur une de mes feuilles un dessin imprécis que je lui demandai d'encrer, en échange de quelques traits posés par elle sur son tissu et d'un poil de pédagogie. Évidemment, j'ai tout taché comme un gros dégueulasse mais j'ai tiré de cette expérience à la fois quelques renseignements sur ma propre pratique, quelques gestes qui étendront le jeu de mes mouvements, et, essentiellement, le sentiment d'avoir partagé avec Aurélie une intense, inhabituelle, intimité.»
L’impasse majeure qui se présente à qui souhaite filmer la bande dessinée au travail, est de considérer qu’elle se limite au dessin, seul geste « spectaculaire » pouvant passer l’épreuve de la représentation audiovisuelle. C’est que le piège est séduisant : le dessin est l’immédiat de la bande dessinée et la naissance du trait, la virtuosité des lignes enchevêtrées, est un « mystère » passionnant à filmer. Mais alors, hormis la captation d’un exploit, au sens presque sportif du terme, qu’a-t-on filmé, qu’a-t-on dit ?
L’ambition de Découverte d'un principe en case 3 est d’outrepasser cette approche strictement contemplative, donc passive et facilement vaine et stérile, pour une approche plus active, envisageant la pratique de la bande dessinée à la fois dans sa dimension magique, mais aussi dans sa dimension laborieuse et collective. Il s’agit de filmer la bande dessinée au travail, avec tout ce que cela suppose d’hésitations, de repentirs, d’incantations et de fulgurances.
Découverte d'un principe en case 3 ne souhaite pas témoigner de la bande dessinée au travail en se contentant de dire : « Voici le dessin qui naît. » Le film n’affirme pas. Il s’interroge : comment la bande dessinée naît-elle ? D’où vient-elle ? Comment s’écrit-elle – si toutefois il est juste de dire qu’elle s’écrit ? Quelles étapes constituent sa genèse ? Quelle place pour le crayonné, pour le brouillon, pour le hasard ? Quelles différences, quelles similitudes, dans le geste créateur d'un auteur et celui d'un autre ? Y a-t-il seulement un dénominateur commun ?
À la question : « Vous sentez-vous plus proche de la famille des arts plastiques ou de celle de la littérature ? », posée par la revue Artpress, l’auteur Marc-Antoine Mathieu répondait : « Je dirais texte de théâtre pour la part bande, graphisme pour la part dessinée, et… cuisine pour la part invisible. Mes textes sont toujours mis en scène, imagés, théâtralisés ; mon dessin, noir et blanc, graphique, tend à devenir signe, voire écriture. La cuisine, elle, est plus difficile à définir. »
C’est cette « cuisine », cette « part invisible », que les contraintes OuBaPiennes collectives nous permettent d’approcher. Dans le processus créatif, dans la mécanique, dans la résolution du défi que pose la contrainte, nous visons à rendre compte de la nature multiple du cœur de la bande dessinée. Excitant pari en vérité : « Chercher l’essence de la bande dessinée, c’est être assuré de trouver, non pas une pénurie, mais une profusion de réponses » (Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, 1999, Presses Universitaires de France).
La rencontre des auteurs dans le cadre de la résidence Pierre Feuille Ciseaux, qui souhaite encourager une bande dessinée différente et en recherche, s’inscrit dans le prolongement de ces réflexions. Conviés à se confronter à mais aussi à inventer des contraintes OuBaPiennes pour les proposer aux autres, les auteurs explorent collectivement les potentiels du médium et poussent au plus loin les expérimentations formelles et narratives.
Cette rencontre, posée en un lieu unique de création et de recherche, permet au film d’introduire la notion de collectif, là où l’on a l’habitude de se représenter l’auteur de bande dessinée seul à sa table de travail.
Que ce huis-clos ait lieu en des murs à l’histoire chargée et à l’architecture impressionnante nous permet également d’élargir la réflexion vers les questions de création en général, d’utopie du collectif, et des rapports pas si éloignés entre les Beaux Arts et les arts dits populaires.
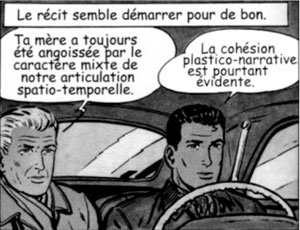
À la différence des reportages classiques sur la bande dessinée, l’enjeu de Découverte d'un principe en case 3 est que les portraits d’artistes se fassent par leur geste, et non par l’impact culturel, social ou symbolique de leur œuvre. Le film, véritable documentaire de création, n’aborde pas la bande dessinée comme le ferait un journaliste. Il n’a pas pour objet de déposer un micro devant un auteur pour, douanier, lui demander : « Qu’avez-vous à déclarer ? » Il est le premier à être confronté aux questions de représentation. Découverte d'un principe en case 3 n’a pas pour objet, répétons-le, de faire la promotion de la bibliographie de tel ou tel artiste, ni de parler édition et chiffres de vente. Ce qui importe ici est de filmer l’artiste au travail, de donner à voir les enjeux de structure et de narration auxquels il se confronte, au-delà de l’écueil classique qui consiste à réduire à la seule question du dessin la bande dessinée lorsqu’elle est filmée. Découverte d'un principe en case 3 envisage la conception de la planche dans sa globalité, depuis l’idée originelle jusqu’à son achèvement, en ne se limitant pas au seul dessin, mais en considérant le processus créatif dans son ensemble. De fait, la question de la mise en scène du travail de la bande dessinée est au cœur du processus de mise en scène.
Une première réponse nous est apportée par la situation de la résidence : circulant entre l’extérieur de la Saline Royale – géométrique, historique, inanimé, impressionnant – et l’intérieur de ses murs – lieu de création, d’énergie, de mouvements et de paroles – le film est pris dans une géographie de l’enfermement et des circulations, ceci depuis l’arrivée des auteurs jusqu’aux locaux à nouveau vides.
Apprivoiser les lieux, en dessiner la topographie singulière, saisir les conséquences de l’irruption soudaine de cette vingtaine de corps étrangers, est l’un des défis posés au film en termes de mise en scène.
Le contexte particulier de la résidence a ceci d’intéressant que, par le ludisme des défis en groupe, il permet d’universaliser les questions de la pratique de la bande dessinée ; et que, par le collectif, par les enjeux de la vie collective et des échanges, il humanise et donne corps à ce qui courait le risque du tout théorique.
Car le second défi posé la mise en scène n’est pas des moindres : comment filmer la bande dessinée ? La question du dessin à l’écran n’est pas neuve : le cinéma s’y est souvent confronté et y a apporté des réponses diverses, notamment face au travail de peintres (Pablo Picasso face à Henri-Georges Clouzot, Jean Miotte face à Raoul Ruiz, Dieric Bouts face à André Delvaux, les toiles de maîtres du Louvre sous l’œil de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, etc.).
La question de la planche de bande dessinée à l’écran est moins fréquente, pour des raisons tant culturelles et symboliques (la bande dessinée est, on l’a dit, souvent considérée comme un art mineur) que pratiques. La planche de bande dessinée a en effet ceci de singulier qu’elle constitue un système narratif global et que la tâche d’en restituer à l’écran la composition générale, la mise en page, la mécanique narrative, est complexe et périlleuse. Réduire la planche à l’élément case relève de la réduction ; passer au banc-titre l’enchaînement des cases revient à forcer une lecture unique et linéaire, donc à réduire, une fois encore, l’œuvre à une dimension de détail.
Volontairement ramené à une équipe technique réduite (un cadreur et un preneur de son) afin de ne pas envahir l’espace, le dispositif du film impose de procéder à des choix forts. Le risque de s’éparpiller en papillonnant d’un groupe à l’autre est ainsi évité. Un micro, une caméra : le film suit ses pistes à l’instinct, prélève clairement des temps forts, se concentre sur certains auteurs, certaines contraintes-clés, ne prétend pas à l’exhaustivité. On sait ce qu’une profusion de caméras dans un château peut amener : ici, la narration et la dramaturgie ne naissent pas des indiscrétions et d’un montage tendancieux. On ne passe pas en revue : on s’arrête sur une étape, on laisse vivre et durer les plans afin d’embrasser tant le labeur, la répétition, l’application, que l’heureuse possibilité de l’accident et de la surprise.
L’auteur parviendra-t-il à « construire le labyrinthe dont il aura à sortir », pour paraphraser la formule par laquelle les OuLiPiens se définissent en 1961 ?
« Je n’ai a priori pas tellement de goût pour l’OuBaPo, confie L.L. De Mars dans son rapport sur l’édition 2009 de Pierre Feuille Ciseaux. J’allais écrire que je n’en ai pas plus pour l’OuLiPo, mais c’est mal formulé, imprécis... Mes relations à l’écriture sous contrainte sont au moins aussi complexes que celles, ambiguës, que j’entretiens avec le jeu d’une manière générale. Je crois tout simplement que l’apparition de la contrainte dans le champ des formulations m’agace à rendre spécifique ce que je crois être, au fond, au travail dans toute oeuvre d’art. Le dégager en le formulant m’apparaît en fait aussi grossier qu’une étiquette de prix laissée sur un cadeau. D’autre part, même si j’étais toujours très heureux de recevoir les étranges fascicules de toutes sortes — des numéros de La Dragée Haute aux recueils de bizarreries du dessin potentiel — que m’expédiait Noël Arnaud, j’avais toujours un mal de chien à excéder l’amusement. Je n’ai jamais pu m’empêcher de voir, assis sur l’épaule de Perec, un petit Perec complaisant riant de ses bonnes farces, et donc jamais pu le lire sereinement.
Et pourtant je suis fou de joie lorsqu'un bref retranchement de la lecture m'offre cette vive petite vue aérienne survolant le plan d'une nouvelle de Balzac tel qu'il apparaît en pleine lumière au détour d'une phrase. Et pourtant je fais absolument mienne la déclaration de Nabokov dans ses cours : « Style et structure sont l'essence d'un livre, les grandes idées ne sont que foutaises. » Et pourtant, je m’obstine à précéder tous mes travaux, qu’ils soient graphiques ou d’écriture, d’un jeu de contraintes écrites si violentes, de plans métrés jusqu’à l’absurde, que je dois admettre être travaillé par la mise en lumière, moi aussi, des machineries. C’est sans doute un jeu salutaire que d’arracher le masque de mysticisme imbécile dont on recouvre généralement la création des oeuvres.
Je ne sais pas à quel moment exactement je me suis senti assez libéré de mes propres habituels impératifs pour m’abandonner à ces exercices que j’avais condamnés si vite et trop fermement... Mais ces jeux à plusieurs mains se sont révélés fécondants là où je m’attendais à les trouver asséchants, et assez riches pour se poursuivre dans mon travail et le changer là où je les imaginais forclos par nature. (…)
C’est ainsi que chez soi s’agrandit. La résidence d’Arc-et-Senans a non seulement agrandi un monde que je croyais à peine assez grand pour mes propres déplacements, mais elle a rendu floues les frontières qui en quadrillent la surface. »
L'OUBAPO PAR L'EXEMPLE
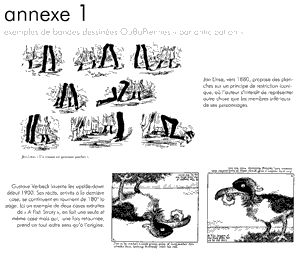
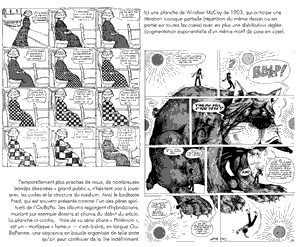
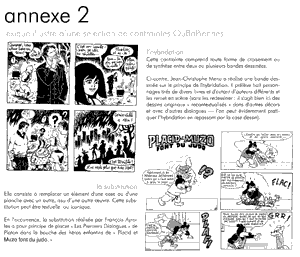
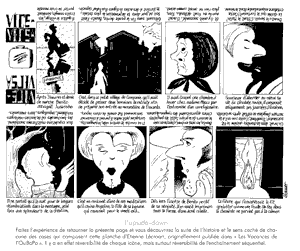
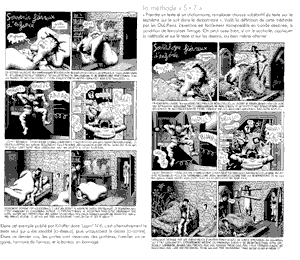
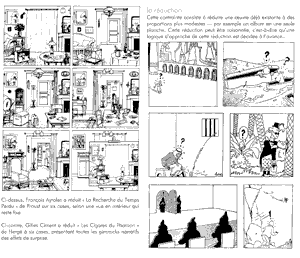
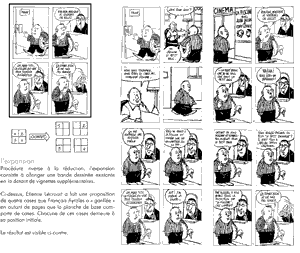
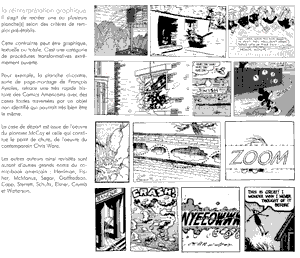
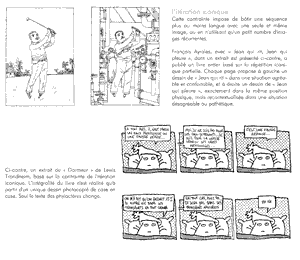
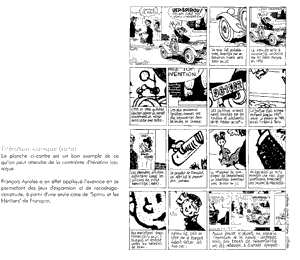
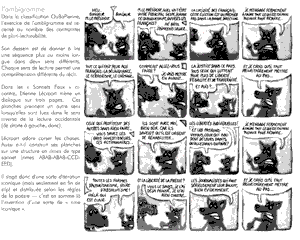
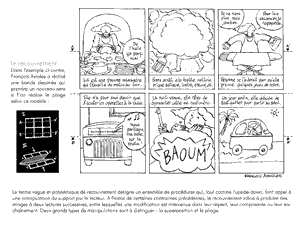
Tous droits réservés.
|